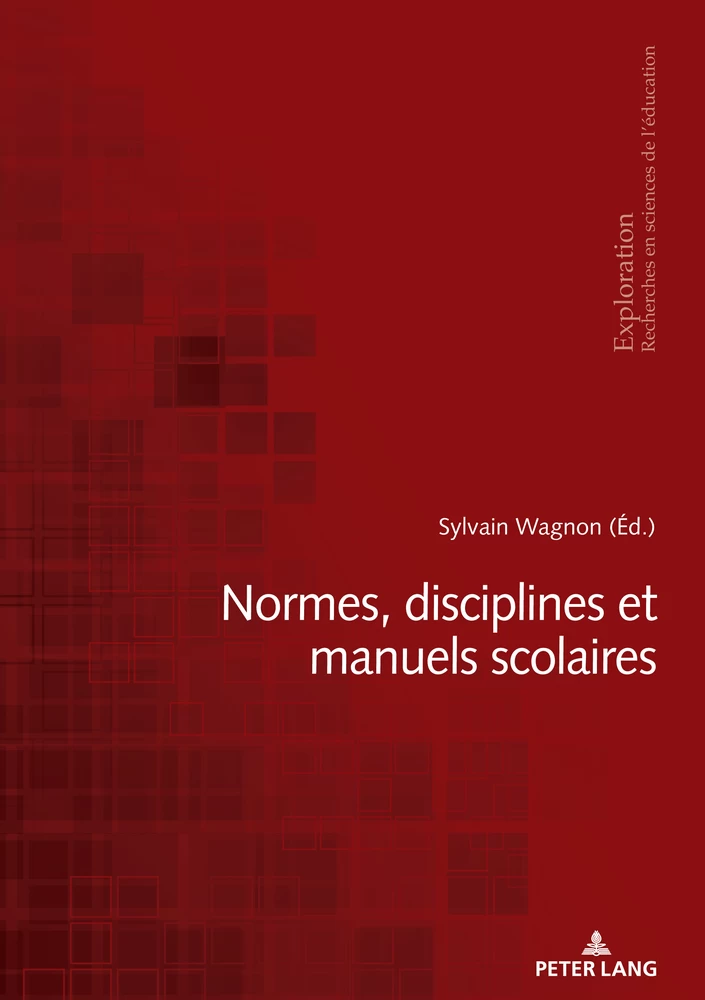Résumé
Grâce à des analyses renouvelées et pluridisciplinaires, cet ouvrage précise l’importance du manuel en tant qu’interface incontournable de l’acte éducatif et élément constitutif d’une culture scolaire. Au fil des contributions issues des plus récentes recherches françaises et suisses, le manuel apparait ainsi comme vecteur de connaissances, de concepts et de valeurs, mais aussi et avant tout interprétation des programmes officiels.
L’étude des liens entre les manuels scolaires et l’évolution de la forme scolaire permet de mettre en évidence les influences des divers acteurs, leurs interactions et les transferts culturels liés à la production des manuels, ainsi que leurs effets sur la constitution des disciplines. Grâce à cette étude novatrice des relations entre les normes, les disciplines et les manuels scolaires, cet ouvrage propose une réflexion globale sur l’enseignement, son histoire, son présent et ses perspectives.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos du directeur de la publication
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction Les manuels scolaires, la forme scolaire et les normes disciplinaires (Sylviane Tinembart et Sylvain Wagnon)
- Première partie Manuels, disciplines scolaires et culture scolaire
- Les manuels de littérature et la fabrication d’une culture scolaire (1880–2000) : l’exemple de Montaigne (Nathalie Denizot et Laetitia Perret)
- Les manuels scolaires et l’histoire des disciplines : enjeux et problèmes (Renaud d’Enfert)
- Romantisme et réalisme dans les manuels de français de seconde professionnelle (2009–2019) (Marie-France Rossignol)
- Seconde partie Les manuels scolaires et l’évolution de la forme scolaire
- Ouvrages et manuels scolaires de grammaire dans la constitution de la discipline Français (Suisse romande, 1830–1910) (Anouk Darme-Xu)
- Enseignants, concepteurs de manuels et artisans de la forme scolaire (Aurélie De Mestral et Viviane Rouiller)
- Les acteurs de l’édition scolaire, chevilles ouvrières de la forme scolaire (Giorgia Masoni et Sylviane Tinembart)
- Troisième partie Manuels et normes scolaires
- Les tâches finales dans trois manuels d’allemand de terminale : perspective actionnelle et normes disciplinaires (Rebecca Laffin)
- Normes disciplinaires, scolaires et sociales : valoriser la coopération par les manuels scolaires pendant l’Entre-deux-guerres ? (Xavier Riondet)
- Analyse de propositions d’enseignement de notions géométriques en cm1 dans les manuels scolaires (Claire Guille-Biel Winder et Édith Petitfour)
- Quels supports et quelles ressources pour enseigner/apprendre ? (Céline Camusson)
- Auteurs
- Résumés
- Titres de la collection
Sylviane Tinembart et Sylvain Wagnon
Introduction
Les manuels scolaires, la forme scolaire et les normes disciplinaires
Normes, disciplines et manuels scolaires : un triptyque complémentaire
Interface entre les multiples acteurs de l’éducation et de l’institution scolaire, enseignants, élèves, parents, auteurs et éditeurs, le manuel scolaire est un outil connu et reconnu. Dans un premier ouvrage collectif, nous avions précisé les enjeux et les perspectives du manuel, défini comme un objet d’étude et de recherche (Wagnon, 2019). Vecteur de connaissances, de concepts et de valeurs, mais aussi et avant tout interprétation des programmes officiels, force est de constater que le manuel engage une nécessaire réflexion globale sur l’enseignement, son histoire, son présent et ses perspectives (Perret-Truchot, 2015). Dans ce second opus, nous avons donc choisi d’analyser le manuel scolaire comme un outil de compréhension des normes disciplinaires et de la forme scolaire.
Il s’agit tout d’abord d’interroger les articulations entre le manuel scolaire et les normes disciplinaires (Denizot, 2016). Le choix de ce premier axe de réflexion nous amène nécessairement à une étude des usages du manuel scolaire par les différents acteurs des disciplines scolaires. À l’intérieur même d’une discipline, les manuels forgent-ils des conditions, des voies d’accès aux savoirs et créent-ils un rapport spécifique à ceux-ci ? Ces questionnements directement issus des débats perceptibles entre les chercheurs présents dans notre premier ouvrage, il paraissait nécessaire d’y répondre ici pour rendre visibles, à partir d’exemples issus de l’espace français et de la Suisse romande, les liens entre le manuel scolaire, les normes disciplinaires et la forme scolaire. Si la question des manuels comme instruments d’un ordre scolaire est posée (Caspard, 1984 ; Choppin, 1992), quelles visions des disciplines véhiculent-ils ? Le manuel scolaire est-il un élément de normalisation des pratiques enseignantes ?
Le second axe de notre réflexion, en lien direct avec celui des normes scolaires, est la confrontation entre le manuel et la notion de forme scolaire. Si l’une des caractéristiques du manuel scolaire est de présenter les connaissances et activités de manière à faciliter leur apprentissage par l’élève (Gerard & Roegiers, 2003), nous avons également souhaité préciser ses influences non seulement sur ←7 | 8→les savoirs, les compétences et les apprentissages au sens large, mais également sur l’organisation spatiale et temporelle de la classe.
Le manuel scolaire, interface incontournable de l’acte éducatif
Témoins de leur temps et objets de recherche (Wagnon, 2019), les manuels scolaires doivent être appréhendés de manière globale (Choppin, 1980). Pionnier dans leur étude, Choppin a démontré que le manuel était une fausse évidence historique (2008), recouvrant une diversité de formats et d’usages avec sa dimension institutionnelle, politique, sociale, culturelle et pédagogique (Choppin, 1993). Outils de mise en œuvre des programmes, traits d’union entre l’institution, les enseignants, les élèves et les parents, les manuels restent des piliers de l’élaboration d’une culture scolaire, pour reprendre le terme de Chervel (1998).
Comme le précise Nóvoa, étudier l’histoire de l’acte éducatif se fait en recherchant les sources capables de « pénétrer dans le noyau des processus de connaissance et d’apprentissage » (1997, p. 13). Or, l’histoire de la culture scolaire (Chervel, 1988, 1998, 2006 ; Denizot, 2021 ; Julia, 1995 ; Wagnon, 2019) ou des pratiques pédagogiques pose simultanément la question de l’espace-classe, du quotidien de cette classe et des outils de ce territoire scolaire spécifique (Héry, 1999, 2005, 2007).
Le manuel scolaire se situe aux confluences de l’émergence des disciplines scolaires et de la forme scolaire moderne. Progressivement, la place qu’occupe peu à peu le livre dans les classes devient centrale :
Les manuels deviennent des dépositaires et vecteurs des savoirs scolaires : dépositaires en tant que véritables institutions dans lesquelles et à travers lesquelles se négocient la sélection, la construction et la transformation des savoirs qui s’y incarnent ; vecteurs en tant que véhicules de transmission de ces savoirs et outils de leur appropriation par les exercices et activités, lesquelles sont « mises en musique » par les discours des enseignants. (Hofstetter & Schneuwly, 2019, p. 43)
Ainsi, les manuels scolaires, par leur pérennité, restent les supports pédagogiques symboles de l’école et de son histoire et on peut légitimement s’interroger sur leur longévité. S’agit-il d’une capacité hors norme de leur part à se renouveler ou sont-ils le symptôme d’une certaine inertie pédagogique ?
Par exemple, en Suisse romande dès la fin du 19e siècle, l’augmentation massive de leur édition et l’accroissement de leur production en réponse aux besoins exprimés par les enseignants et soutenus par les départements cantonaux de l’Instruction publique suscitent même des ambitions, voire des vocations. Des instituteurs se muent alors en auteurs et en éditeurs (Tinembart, ←8 | 9→2019) alors que les autorités scolaires entrevoient aussi la garantie d’harmoniser l’enseignement et de mettre en œuvre les prescriptions quant aux différentes disciplines (Heinze, 2011). En comparant les contenus d’enseignement, les recherches mettent en lumière la mutation progressive des matières d’enseignement en disciplines scolaires dans un long processus de disciplinarisation (De Mestral, 2018 ; Extermann, 2013 ; Masoni, 2019 ; Monnier, 2015 ; Rouiller, 2018 ; Tinembart & Darme, 2016). Les responsables au niveau de l’État estiment alors légitime de maîtriser le processus éditorial des manuels et de les officialiser. Pour ce faire, ils mandatent des auteurs, des illustrateurs, des imprimeurs et des libraires pour concevoir des manuels correspondant aux programmes officiels et aux différents degrés de la scolarité. Ces ouvrages sont souvent spécifiques à chaque discipline d’enseignement, revêtent peu à peu un caractère obligatoire et sont distribués progressivement à tous les élèves, entrainant ainsi une forte progression du marché de l’édition scolaire.
Au début du 20e siècle alors même que les manuels étaient fournis et utilisés de plus en plus massivement dans les classes, les pédagogues d’éducation nouvelle, comme Célestin Freinet, ont critiqué l’omniprésence des manuels, supports qui empêcheraient une réflexion autonome des élèves (Go, 2007 ; Go & Riondet, 2018 ; Reverdy, 2017). Même si le mot d’ordre « plus de manuel scolaire » était avant tout une volonté d’en questionner les usages plutôt que de bannir ces moyens d’enseignement en tant que tels, cette réaction était alors bien une offensive contre un enseignement traditionnel hérité du siècle précédent (Freinet, 1964).
Résumé des informations
- Pages
- 230
- Année
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9782875744623
- ISBN (ePUB)
- 9782875744630
- ISBN (Broché)
- 9782875744616
- DOI
- 10.3726/b19294
- Langue
- français
- Date de parution
- 2022 (Février)
- Mots clés
- l’importance du manuel scolaire Le manuel scolaire et des évolutions de nos systèmes éducatifs Les manuels scolaires et l’évolution de la forme scolaire
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 230 p., 1 ill. en couleurs, 28 ill. n/b.